Mémoire du patois de Sologne bourbonnaise
Réédition
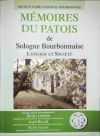
B
rèves d'histoire : À Moulins il y a 50 ans : le chantier de la trémie !
Le samedi 4 novembre 2023 à 15 heures à l'auditorium du Musée Anne-de-Beaujeu à Moulins, Fabien Conord, professeur des universités, chef de département adjoint information-communication option Journalisme à l’université Clermont Auvergne a évoqué « Camille Gagnon, historien et magistrat ».
Camille Gagnon (1893-1983), fils d'un notaire d'Ygrande, a accompli une carrière judiciaire particulièrement aboutie. Il fut notamment président du tribunal de première instance de Montluçon (1940-1950), président de chambre à la Cour d'appel de Riom de 1950 à 1960 et a terminé son itinéraire professionnel comme premier président de la Cour d'appel de Bourges. Camille Gagnon fut aussi un historien passionné, actif dans plusieurs sociétés savantes (dont la Société d'émulation du Bourbonnais) et auteur de multiples ouvrages.
Fabien Conord est professeur d'histoire contemporaine à l'université Clermont Auvergne. Il est membre de plusieurs comités scientifiques et conseils scientifiques, dont la revue allemande Perspektiven auf die Romania, la SFHPo (Société française d’histoire politique) et l'APHG (Association des Professeurs d’histoire-géographie). Il a dirigé successivement trois départements de l’IUT d’Allier dont il a également été directeur adjoint. Actuellement, il est le chef adjoint de département information-communication option Journalisme à l’université Clermont Auvergne. Ses recherches portent sur les groupes sociaux (paysans et magistrats essentiellement) et les pratiques sociales (militantisme politique ou syndical, activités sportives). Il a dirigé un ouvrage collectif sur l’histoire du radicalisme en Europe du XIXe siècle à nos jours, à paraître fin 2021. Il travaille notamment avec l’historien Julien Bouchet. Il coordonne également deux recherches collectives qui portent respectivement sur « Olympisme et culture » et « Les écrivains paysans dans les pays de langues romanes ».
La conférence a porté sur la double dimension d'historien et de magistrat de Camille Gagnon. Les membres de la Société d'émulation du Bourbonnais ont pu découvrir la carrière judiciaire de Camille Gagnon ainsi que son engagement dans la recherche historique.
La conférence sera publiée dans le bulletin trimestriel de la Société d'émulation du Bourbonnais.
Fabien Conord : « Camille Gagnon, historien et magistrat ».
Madame Pascale Trimbach, Préfet de l’Allier,
vous invite à assister à la conférence « Le Soldat inconnu et la Flamme, genèse et postérité » organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais.
Une conférence animée par Madame Pascale Trimbach, Préfet de l’Allier, Commissaire au Comité de la Flamme et Monsieur Jean-Luc Demandre, président de l’association « Connaissance de la Meuse ».
Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 8 novembre 2023.
Par courriel à pref-evenements@allier.gouv.fr (En indiquant vos noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse courriel)
C
onférences vendredi 10 novembre 2023 à 19h30 en préfecture de l'Allier, à Moulins et samedi 11 novembre 2023 à 12h30 en sous-préfecture de Vichy :
Pascale Trimbach, Préfet de l'Allier, Commissaire au Comité de la Flamme et de Monsieur Jean-Luc Demandre, président de l’association « Connaissance de la Meuse » :
« Le Soldat inconnu et la Flamme, genèse et postérité »

Joseph Sorrel (1846-1923) "L'homme, le tanneur, le maire républicain de Moulins"
Pierre Bordes
V
ient de paraître
- Pascal Chambriard : "La découverte touristique de la vallée du Jolan au XIXème siècle et la Ronde de l'Empereur aux Malavaux".
- Victor et Wandrille Gosset : "Célébration du 140ème anniversaire de la naissance de Jacques Chevalier et du 60ème anniversaire de sa mort".
- Pierre Magnard : "Jacques Chevalier, passeur d'éternité".
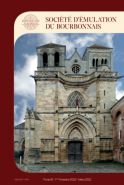
La trémie située à l’extrémité du pont Régemortes aura 50 ans en 2024. Elle est l’élément le plus emblématique du patrimoine moulinois datant d’une époque marquée par le règne sans partage de l’automobile. Au tournant des années 60 et 70 la plupart des villes s‘adaptent à l’automobile. Paris se dote d’une voie express sur berge en rive droite en 1967 et débat en 1971 de celle de la rive gauche et d’une pénétrante autoroutière nord/sud. À Lyon les travaux de traversée de Perrache par l’autoroute s’engagent en 1972, alors que Chalon-sur-Saône et Saint-Chamond aménagent des autoponts pour tenter de limiter les bouchons, également en 1971.
Les propos du directeur général des services de la ville de Moulins dans le bulletin municipal de 1971 reflètent parfaitement ce temps de l’automobile reine : « Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore le développement de l’automobile est un fait. Nous devons le constater et en tirer les conséquences ». « Que faire pour éviter la paralysie… élargir les chaussées, autant que faire se pourra, augmenter les places de stationnement, instituer le stationnement payant… ». Et de conclure « la conservation des vestiges du passé, qui ne sont parfois que de simples souvenirs, ne doit point paralyser l’expansion de la ville. »
En 1971 les axes routiers nord-sud (RN7, RN9) et est-ouest (RN73, RN145) se croisent au cœur de Moulins. Le contournement de l’agglomération n’est pas encore d’actualité et la future RCEA n’est qu’un projet (le pont RCEA de Chemilly ouvrira en 1977). Le pont Régemortes est un point névralgique, dont les accès sont régulièrement engorgés. La part du trafic poids-lourds est croissante. En 5 ans, de 1965 à 1970, le nombre de poids-lourds traversant Moulins a plus que doublé ! Et la traversée de Moulins lors des grands départs estivaux semble interminable à nombre de vacanciers
Trois projets sont étudiés par les services de l’État : un autopont, une voie sur berge, ou une trémie. L’hypothèse d’un autopont est rapidement exclue car il n’est pas envisageable de créer un tel ouvrage dans le prolongement d’un pont protégé au titre des monuments historiques ! En mai 1971, le conseil municipal de Moulins, présidé par son nouveau maire Hector Rolland depuis l’élection de mars, adopte donc, sur proposition de l’État, la réalisation d’une voie sur berge qui partirait de la rue Félix Mathé et aboutirait quai d’Allier après passage sous la première arche du pont deux mètres au-dessus du niveau du radier.
Mais, en janvier 1972, le conseil municipal revient sur cette décision au motif que « pour supprimer l’intersection du trafic en tête de pont on créerait deux points de cisaillement, un en amont, un en aval du pont... » et opte pour la réalisation d’une trémie.
Des travaux préliminaires affectent le pont lui-même. Afin de donner toute sa place à l’automobile on réduit la largeur des trottoirs pour aménager une troisième voie de circulation. On démolit les bâtiments d’octroi présents en tête de pont. Cette destruction soulève de vives critiques de défenseurs du patrimoine.
La réalisation des voies latérales à la trémie implique un remblaiement entre la rivière et la levée pour disposer d’une largeur de voierie suffisante. Cinq mille tonnes d’enrochements sont mis en œuvre à cette fin en 1973.
Le chantier donne lieu également à de considérables travaux affectant les réseaux d’eau, d’assainissement, de gaz et d’électricité. Ce chantier devant rendre la circulation temporairement plus difficile sur le pont, le maire de Moulins a bien tenté d’obtenir de l’armée la mise à disposition d’un pont provisoire le temps nécessaire aux travaux. Demande refusée en mai 1973 « compte tenu des contraintes techniques et charges militaires… ».
En 1974 s’engage la phase de terrassement avec le décaissement du passage sous la tête de pont après mise en place d’un rideau de palplanches métalliques, puis la réalisation des murs de soutènement et de la dalle de béton supportant le passage supérieur. Ce chantier spectaculaire suscite alors la curiosité des Moulinois !
Fin novembre 1974 la trémie est ouverte à la circulation. Elle devient emblématique de la nouvelle image que se donne la ville puisqu’elle figure de manière stylisée en couverture du bulletin municipal de 1973 à 1976 ! Mais, dès 1975, une pétition de riverains considère « que le bouchon n’a été que déplacé vers l’avenue d’Orvilliers… ». Et le débat va s’engager sur l’opportunité et le tracé d’une rocade de contournement de l’agglomération et, qui sait peut-être un jour, d’un second pont…
Jean-luc Galland
Illustrations et sources
Photographies : archives municipales de Moulins avec leur autorisation.
Dossier des délibérations, courriers et pièces administratives du chantier de la trémie aux archives municipales de Moulins
Bulletins municipaux 1971/1976 Moulins, bibliothèque de la SEB
Merci à l’équipe des archives municipales pour son accueil et son concours.
Mise à jour de l'inventaire des archives (avril 2023) rubrique : Collections & Publications / Bibliothèque / mise en ligne des sommaires des Annales Bourbonnaises et La Revue Bourbonnaise
D
ernier bulletin

TOME 81
SEPTEMBRE 2023
Samedi 17 février 2024- 15h
Amphithéâtre de la Salle des Fêtes de Moulins
Thierry Martin-Douyat
Le film « l’Allier entre Résistance et Occupation »
Samedi 2 mars 2024- 15h
Auditorium du Musée Anne de Beaujeu Moulins
Claude Cajat
« Au Marais, au Louvre, à Versailles : évolution et influence du sculpteur moulinois Thomas Regnaudin »
Samedi 9 mars 2024- 15h
Cinéma René Fallet- Dompierre-sur-Besbre
En collaboration avec la Société Philatélique de Moulins
- Loman-Pierre Charrier
« Présentation des métayers dans le Bourbonnais, de la fin du XIXe siècle à leur disparition »
- Hélène Saint-André
« Les bombardements dans l’Allier pendant la seconde guerre mondiale »
« Présentation des métayers dans le Bourbonnais, de la fin du XIXe siècle à leur disparition »
- Hélène Saint-André
« Les bombardements dans l’Allier pendant la seconde guerre mondiale »
Samedi 6 avril 2024- 15h
Auditorium du musée Anne de Beaujeu Moulins
Fabien Delrieu
« Les fouilles de Bègues et de Jenzat »
Samedi 4 mai 2024- 15h
Auditorium du Musée Anne de Beaujeu Moulins
Joelle Chalancon
« Vie et carrière de Pierre d’Urfé »
Samedi 18 mai 2024- 15h
Maison Diocésaine Moulins
Hugo Fréby
« Les flèches de pierre en Bourbonnais »
Samedi 1er juin 2024- 15h
Auditorium du Musée Anne de Beaujeu Moulins
Daniele Rivoletti
« Sculptures bourbonnaises »
Samedi 15 juin 2024- 15h
Salle Gabrielle d’Estrées à Neuilly-le-Réal
En collaboration avec l’Association « Neuilly Hier et Demain»
- Georges et Christiane Chatard
« Les relais de poste sur le chemin royal de Paris à Lyon dans la traversée du Bourbonnais »
- Clément Dionet
« Promenade sur le route royale de Lapalisse à La Pacaudière : l’appel de l’Italie »
« Les relais de poste sur le chemin royal de Paris à Lyon dans la traversée du Bourbonnais »
- Clément Dionet
« Promenade sur le route royale de Lapalisse à La Pacaudière : l’appel de l’Italie »
Agenda
Société d'Emulation du Bourbonnais
Ouverture de la bibliothèque tous les mercredi de 14h à 17h30
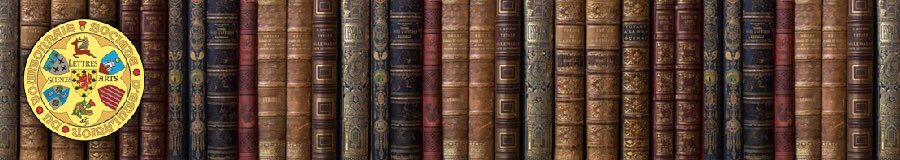


Mise à jour : 05.11.2023
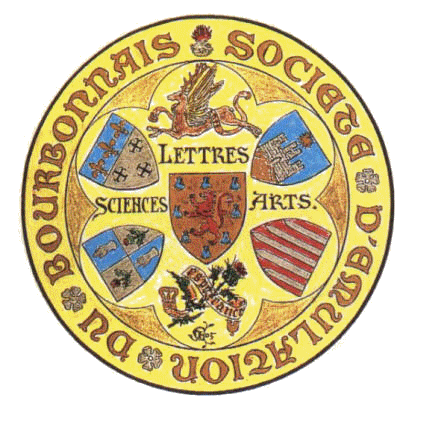
93, rue de Paris - 04.70.34.08.13 - emulation.bourbonnais@orange.fr